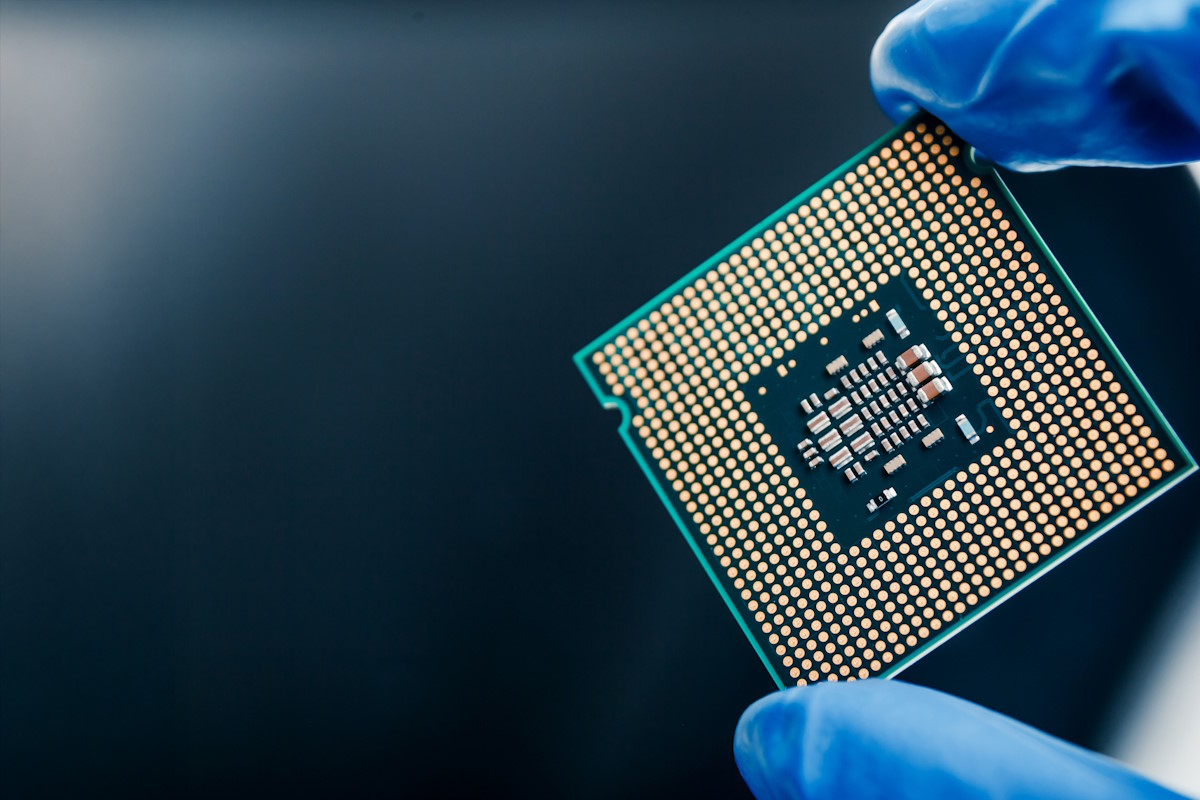Un nouvel espoir : la reprise en cours du marché des puces.
Le marché des puces a généré près de 700 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière, en hausse de +21 % en glissement annuel, et devrait enregistrer un TCAC d'environ +10 % au cours de l'année à venir pour devenir un marché d'un billion de dollars d'ici 2029/2030. Le rebond fait suite à deux années de faible performance (+1 % en 2022 et -10 % en 2023) héritées de la pénible période de pénurie de puces post-pandémie et de l'explosion soudaine de la demande d'appareils informatiques. Les revenus futurs devraient être principalement tirés par l'intégration progressive d'outils d'IA générative dans les appareils électroniques (+8 % de TCAC sur la période 2024-2028 pour les appareils portables) et les solutions informatiques (+12 % de TCAC), mais aussi par un déploiement à grande échelle de la technologie 5G sur le marché de la téléphonie mobile (+12 % de TCAC) et par une envolée des investissements dans les centres de données (+15-20 % de TCAC).
Fragmentée à travers la galaxie : la chaîne d'approvisionnement des puces est devenue de plus en plus complexe et dispersée à travers le monde.
La chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs est divisée en différents pools d'expertise/capacité de pointe, où un ou deux pays ont tendance à dominer. En résumé, la Chine contrôle l'approvisionnement en matières premières grâce à ses importantes réserves et capacités de raffinage d'éléments de terres rares, tandis que les États-Unis dominent les segments de la propriété intellectuelle et de la conception. La Chine et Taïwan ont les plus grandes capacités de fabrication et l'Asie du Sud-Est s'est spécialisée dans le segment de l'assemblage, des tests et du conditionnement (ATP). L'Europe semble être l'outsider dans ce secteur, mais elle fait preuve d'une réelle expertise sur le marché des équipements, ainsi que dans les puces automobiles, grâce à des partenariats stratégiques avec les plus grands équipementiers européens.
Les empires se font la guerre : les tensions géopolitiques s'intensifient.
Les superpuissances économiques ont mis en place des politiques concurrentes en matière de puces à mesure que les tensions commerciales s'intensifient. À l'instar de la Chine et des États-Unis, l'Europe a dévoilé sa propre version de la politique industrielle des puces avec l'European Chip Act et s'est fixé un objectif audacieux : atteindre 20 % de production nationale de puces d'ici 2030. Mais contrairement à ses pairs, l'objectif de l'Europe semble hors de portée à ce stade, notamment en raison d'un énorme différentiel d'investissements en capital avec la Chine et les États-Unis, qui ont tous deux déployé plus de 100 milliards de dollars en subventions et prêts pour développer leurs capacités et renforcer leurs industries. Nous assistons également à une course au leadership technologique entre les nations, plaçant les semi-conducteurs au centre d'un jeu géopolitique dans lequel ils sont utilisés comme monnaie d'échange pour accroître l'influence économique et/ou contenir l'expansion des rivaux. Du point de vue du marché, de nouvelles tensions commerciales ne remettront pas en cause la reprise induite par l'IA sur le long terme, mais elles pourraient ouvrir la voie à de nouveaux épisodes de type « Deepseek » à mesure que la surveillance des investisseurs s'intensifie.
L'Europe doit utiliser la force de son cerveau plutôt que de montrer ses muscles.
L'industrie des puces est très coûteuse, tant en phase de R&D qu'en phase industrielle : une usine moderne coûte environ 15 à 20 milliards de dollars. L'Europe part de trop loin pour espérer combler rapidement son retard par rapport à ses pairs, tandis que sa faible productivité limite sa capacité à être compétitive sur le marché. En outre, d'un point de vue industriel, il ne serait pas pertinent pour l'Europe de commencer à produire des puces pour l'électronique grand public et les ordinateurs, car ces produits ne sont pas fabriqués en Europe. Il serait en revanche judicieux de cibler et de développer les capacités de production de puces sur la base de synergies potentielles avec des secteurs dans lesquels l'Europe est leader, tels que l'automobile, la chimie, la défense ou la santé.
Comment les européens peuvent-ils revenir en force ?
Les puces étant au cœur de nombreux secteurs, de l'automobile à la défense en passant par l'IA, nous insistons sur le fait que les investissements destinés à soutenir ces secteurs devraient être en partie orientés vers les semi-conducteurs. Nous proposons notamment les cinq mesures suivantes pour que l'Europe se remette dans la course mondiale aux puces :
- Établir une feuille de route claire et coordonnée pour développer l'expertise en matière de semi-conducteurs dans les secteurs où l'Europe a un intérêt économique ou stratégique (c'est-à-dire l'automobile, la défense ou la santé). Un investissement précoce pourrait favoriser les synergies économiques tout en soutenant le développement d'un leadership d'expertise qui serait utile, en particulier lorsque l'Europe a l'intention d'accroître et de moderniser ses capacités militaires. Une partie de l'augmentation prévue des dépenses de défense (environ 3 % du PIB, avec un ratio cible de 35 à 40 % alloué à l'équipement/R&D) pourrait contribuer au financement de nouvelles capacités en matière de puces.
- Développer et soutenir son expertise en matière d'équipements semi-conducteurs afin de défendre son leadership actuel dans ce segment. Cela impliquerait d'investir davantage pour accroître les capacités tout en reproduisant le succès pour aider à développer de nouveaux acteurs, et également se protéger contre la concurrence déloyale et l'espionnage industriel.
- Multiplier les partenariats entre entreprises et écoles d'ingénieurs pour créer un véritable écosystème national dédié à l'IA et à la R&D dans les nouvelles technologies. L'Europe devrait tirer parti de son expertise en ingénierie pour réduire de moitié le taux de mobilité actuel des docteurs européens dans le secteur technologique, qui se situe entre 40 et 50 %. Dans ce contexte, il serait plus approprié de réaligner l'objectif de la loi européenne sur les puces électroniques, qui est de 20 % de part de marché d'ici 2030, en mettant l'accent sur les activités en amont.
- Consacrer au moins 0,5 % du PIB par an (35 à 40 milliards d'euros) à la R&D et aux nouvelles capacités en encourageant les investissements des fonderies asiatiques et américaines sur le sol européen (réduction d'impôts, prêts à taux préférentiels, fonds publics, procédure accélérée d'acquisition de terrains, etc.). En complément du programme de financement de la loi sur les puces, cela pourrait être mis en œuvre en puisant dans les fonds et les facilités existants tels que le Mécanisme pour l'interconnexion en Europe, le programme InvestEU de la BEI, etc.
- Consacrer au moins 10 à 15 % de l'initiative européenne InvestAI (soit 20 à 30 milliards d'euros) à des investissements à grande échelle dans les centres de données et à l'approvisionnement et au développement d'une chaîne d'approvisionnement sécurisée entièrement dédiée à l'Europe.